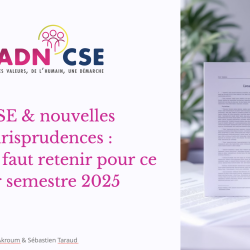Évolution de la représentation des salariés depuis la création des CSE : si on faisait le point ?
Une réforme majeure du dialogue social en 2017
Avec les ordonnances « Macron » de 2017, les instances représentatives du personnel (IRP) – délégués du personnel, comités d’entreprise (CE), CHSCT, délégations uniques du personnel – ont été fusionnées en une instance unique : le Comité Social et Économique (CSE).
L’objectif était clair : simplifier le paysage de la représentation, renforcer l’efficacité du dialogue social et offrir une meilleure lisibilité aux salariés comme aux employeurs.
Une couverture en baisse entre 2017 et 2023
Les chiffres montrent pourtant une légère érosion de la représentation. En 2017, 64 % des établissements de plus de 10 salariés disposaient d’instances élues ; en 2023, ils ne sont plus que 61 %.
Cette baisse est particulièrement marquée dans les entreprises mono-établissement : seulement 43 % sont couvertes par une instance élue en 2023, contre 48 % six ans plus tôt. À l’inverse, dans les entreprises multisites, la couverture reste stable autour de 80 %, mais avec une tendance forte à la centralisation des mandats.
La centralisation des mandats : un défi pour la proximité
La réforme a permis une rationalisation, mais elle a aussi concentré la représentation. Dans les groupes multi-établissements, le périmètre des CSE couvre désormais plus souvent l’ensemble de l’entreprise (46 % des cas en 2023, contre 22 % en 2017). Résultat : la proximité avec les salariés peut s’en trouver affaiblie.
Pour y remédier, les ordonnances ont introduit la possibilité de désigner des représentants de proximité. En 2023, 22 % des établissements de structures multisites en disposent. Mais ces représentants ne sont pas systématiques et leur rôle reste encore limité.
Une réduction du nombre d’élus, surtout dans les grandes entreprises
Un autre constat majeur est la diminution du nombre d’élus. Les représentants du personnel notent que les CSE regroupent moins de sièges que l’ensemble des anciennes IRP. Cette contraction touche particulièrement les grandes entreprises, où le sentiment de perte de proximité et de moyens est le plus fort.
La transformation des missions : santé, sécurité et conditions de travail
La moitié des établissements dotés d’un CSE déclarent aujourd’hui disposer d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Si elle est obligatoire à partir de 300 salariés, 66 % des entreprises de 50 à 299 salariés en sont aussi équipées, contre 79 % qui disposaient auparavant d’un CHSCT. Ce chiffre illustre bien la transition : la prévention des risques et la qualité de vie au travail demeurent des enjeux centraux, mais avec des modalités d’action qui se sont transformées.
Une reconnaissance encore partielle
Du côté des élus, la perception reste contrastée. L’enquête Réponse 2023 révèle que beaucoup estiment que le dialogue social reste perfectible, notamment en termes de reconnaissance par la direction et de moyens alloués.
Dans de nombreuses entreprises, la charge de travail des élus et le manque de temps sont cités comme des freins à une représentation pleinement efficace.
Ce que cela dit du dialogue social aujourd’hui
Six ans après leur création, les CSE sont désormais installés dans le paysage. Ils ont simplifié le système, mais parfois au prix d’une perte de proximité avec les salariés.
Les enjeux restent nombreux : renforcer les moyens, soutenir la formation des élus, et mieux articuler centralisation et représentation de terrain.
Car la qualité du dialogue social ne dépend pas seulement des textes, mais aussi de la manière dont élus et directions s’en saisissent pour créer un espace d’écoute et de construction collective.
Sources : DARES – » Comment évoluent l’implantation et l’organisation de la représentation des salariés depuis la création des comités sociaux et économiques (CSE) ? » – 24 juillet 2025